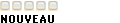Lorsque la sociologie tente de cerner ce qu'est la philosophie, celle-ci, inévitablement se braque, prétextant que personne ne peut la comprendre mieux qu'elle-même...
l faut une analyse extérieure : Je n’ai pas connaissance qu’un tel travail existe. J’ai cherché désespérément une « étude sociologique du rôle de la philosophie », ou encore une « étude du rôle historique de la philosophie » ou encore une « analyse sociologique des apports de la philosophie dans l’histoire des idées humaines », mais rien, néant, nom de domaine inconnu. Il n'existe pas de travail d'ensemble qui ferait la synthèse de divers études sur ce sujet ; D'ailleurs il existe très peu d'études particulières sur le sujet ! Louis Pinto, [dont le parcours est ici plus que pertinent : sociologue et philosophe à la fois est directeur de recherche au CNRS] proche de Bourdieu, a le mérite d'être l'un des rares sociologues à s'être penché sur le problème et y avoir consacré quelques précieux articles. On peut citer aussi C. Soulié, également proche de Bourdieu dont voici un extrait de de son article Anatomie du gout philosophique, paru dans la revue Actes de la Recherches en sciences sociales.
« La philosophie se présente souvent comme une activité qui est à elle-même sa propre détermination. Ainsi quand on interroge un enseignant ou un étudiant de cette discipline sur son parcours intellectuel, il y a de fortes probabilités pour que celui-ci le décrive comme étant essentiellement déterminés par des raisons d’ordre purement intellectuel. A l’écouter, c’est son intérêt pour tel auteur, telle question ou telle problématique qui l’aura pousser à lui consacrer une ou plusieurs années de sa vie. L’enquête que nous avons mené au sujet des pratiques de recherche des étudiants en philosophie de la région parisienne permet de dépasser ce type d’explication, et nous voudrions montrer ici ce que la réflexion philosophique doit à son enracinement institutionnel, comme aux usages sociaux qui en sont faits.
Notre volonté d’étudier la discipline philosophique d’un point de vue sociologique n’a pas manqué de susciter des réactions, parfois très vives, notamment dans la population dominante de cet univers, c’est-à-dire chez les normaliens agrégés. En raison de leur appartenance disciplinaire, ces derniers ont souvent tendance à se penser comme des professionnels de la lucidité et de la réflexivité, réflexivité dont la philosophie aurait en quelque sorte le monopole, les autres disciplines étant souvent jugées incapables d’opérer un retour réflexif sur les savoirs particuliers ou régionaux qu’elles élaborent. Se posait alors la question même de la légitimité, et de l’intérêt, de la démarche sociologique. Faisant leur propre histoire, ayant leur propre pédagogie (un inspecteur général de la discipline ne cesse notamment de répéter que « la philosophie est à elle-même sa propre pédagogie », les philosophes professionnels, comme les apprentis philosophes, manifestent fréquemment un certain scepticisme, voire une franche hostilité, vis-à-vis d’une démarche souvent perçue, a priori, comme réductrice. Ce type d’obstacle, particulièrement sensible lors des interviews, nous a notamment conduit à privilégier l’approche statistique ainsi que l’étude des pratiques." Ce texte est intégralement disponible sur http://philo-analysis.com
Qu'en pensez-vous ?
Quelqu'un aurait-il d'autres pistes de lectures ?

-----