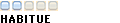Salut à tous !
Au programme de littérature cette année, un poète français, Yves Bonnefoy, dont l'idée centrale est que le concept, le discours, ne recouvre pas l'être : exemple de base, typiquement bonnefoyen, pour Ruth la glaneuse, le blé fauché, ramassé, stocké et négocié n'est pas le blé : c'est un concept du blé, qui a permis de le mettre en culture, d'organiser sa récolte, c'est une richesse, quelque chose qui va se vendre, fructifier, nourrir : ce blé, tel qu'on le pense dans l'action de faucher, est une abstraction. Ruth a perdu le rapport qu'elle avait avec le vrai blé : celui de la glaneuse qu'on autorisé à récolter ici et là quelques épis dans le champ, pour survivre : elle a perdu le rapport intime avec la chose, une chose, toujours particulière.
C'est la mê^me idée chez Hobbes, qui choisit la mécanique (c'est-à-dire la description, dans la dimension, dominée par la raison, de la géométrie euclidienne, de rapports entre les corps) et s'interdit toute tentative ontologique. Hobbes est un nominaliste, pour lui, le langage qui est le monde du concept, de l'abstrait, ne recouvre par l'être profond de la chose, toujours unique.
Pour replacer cela sur le plan scientifique, on peut citer Duhem, qui décrit l'expérience physique (et scientifique, en général), comme une reconstruction, conceptuelle, abstraite, des faits observés, c'est-à-dire (c'est moi qui traduit cela comme çaune "image", un reproduction postérieur, effectuée dans la dimension du concept scientifique — à noter que chez lui, cela justifie le fait que l'expérience ne peut réfuter la théorie : l'expérience ne se fait pas "sur le terrain", mais dans un carcan, une épaisseur théorique, où elle n'est que le "fantôme" des faits.
Alors, ma question : le discours scientifique, et d'une manière plus général, le discours rationnel, recouvre-t-il adéquatement le réel ? en rend-t-il compte ? ou n'en est-il qu'une reproduction abstraite ?
À vous.
-----


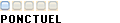

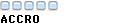



 Oui, en fait je viens de découvrir que la définition de la perception* comprend l'usage de représentations. Selon cette définition, je suis d'accord avec toi. Mes posts avaient une tout autre conception de la perception: celle, uniquement, de recevoir des formes par les sens.
Oui, en fait je viens de découvrir que la définition de la perception* comprend l'usage de représentations. Selon cette définition, je suis d'accord avec toi. Mes posts avaient une tout autre conception de la perception: celle, uniquement, de recevoir des formes par les sens.